“Connecter les savoirs, façonner les futurs : la transdisciplinarité dans la recherche”
Cet évènement est passé !
Organisée dans le cadre de l’Université d’été des doctorantes et doctorants Charm-EU, la conférence internationale « Bridging minds, shaping futures : transdisciplinary in research » se décline en une série d’interventions inspirantes de neuf scientifiques de renommée internationale issus des universités européennes membres de l’alliance Charm-EU.

Rapprocher les individus et les savoirs, relier les communautés, croiser les modes de pensée… La recherche transdisciplinaire est plus que jamais nécessaire pour relever les défis chaque jour plus complexes, interreliés et planétaires, que le monde affronte. Des problématiques touchant simultanément à la santé, l’environnement, l’alimentation, la politique … Si nous souhaitons y apporter des solutions durables et impactantes, nous devons connecter les savoirs comme les idées au-delà des frontières géographiques et académiques. Et ce tout en favorisant des interactions riches avec la société civile, les entreprises, les citoyennes et citoyens.
Cette conférence dresse un panorama non exhaustif et inspirant de projets menés dans les universités de l’alliance européenne Charm-EU. Elle est organisée dans le cadre de sa première université d’été à destination des doctorantes et doctorants, laquelle a pour thème : « Developing transdisciplinary practice to tackle complex challenges ». Les conférencières et conférenciers internationaux invités sont des chercheurs et chercheuses de premier plan qui ont mis la transdisciplinarité au cœur de leur travail. Ils ont en commun une excellence dans la recherche et un engagement profond à contribuer à une société plus durable. Leurs domaines d’expertise sont vastes : philosophie, droit, physique, hydrogéologie, épidémiologie, médecine… Leur donner la parole est l’occasion de montrer à étudiants et étudiants, doctorantes et doctorants, personnel enseignant comme personnel de recherche, que la transdisciplinarité peut faire bouger la recherche. Une formidable source d’inspiration pour nourrir la recherche de demain.
Programme détaillé de la conférence
8.30-9.00 – Accueil café
9.00-9.15 – Discours d’inauguration
par Philippe Augé, président de l’Université de Montpellier
Suivi de la remise des Prix de thèse interdisciplinaire 2024 du Collège doctoral de l’Université de Montpellier
9.15-12.30 – Session du matin
9.15-9.50 – Laura Hellsten, Université Åbo Akademi, Finlande
La boîte à outils transdisciplinaire : ce que j’ai appris en menant une recherche ethnographique dans un projet de recherche interdisciplinaire.
En savoir +
À partir des résultats du travail de terrain réalisé dans le cadre d’un projet de recherche interdisciplinaire, ainsi que des collaborations transdisciplinaires qu’elle a contribué à faciliter, Laura Hellsten partagera les meilleures pratiques et abordera les compétences et aptitudes nécessaires à la recherche transdisciplinaire. En s’appuyant sur les descriptions de la recherche inter-, multi- et transdisciplinaire proposées par Lawrence et al. (2022), cette conférence proposera des outils permettant de s’orienter vers l’acquisition des différents types de savoirs mobilisables dans les collaborations scientifiques : savoirs d’orientation, savoirs systémiques, savoirs procéduraux et savoirs transformationnels.

Laura Hellsten
Chercheuse postdoctorale en théologie
Université Åbo Akademi, Finlande
Doctorat en théologie systématique
Dans le cadre de son premier poste postdoctoral, au sein du Centre d’excellence BACE de la fondation Stiftelsen Åbo Akademi, Laura Hellsten a étudié les interactions au sein d’une équipe de chercheurs en physique, chimie et biologie cellulaire. La collaboration BACE portait sur le développement d’une plateforme d’activation bioélectronique permettant de contrôler les signaux cellulaires et, par conséquent, de stimuler certaines fonctions cellulaires. Elle a mené un travail de terrain ethnographique auprès de ce groupe de recherche, s’intéressant aux questions d’éthique et de communication scientifique.
Afin d’approfondir l’étude de la communication scientifique, Laura Hellsten a conçu et dirigé le projet de recherche Avtryck i det okända – Forcing the Impossible (2020–2022), qui a favorisé des collaborations transdisciplinaires entre artistes et chercheurs dans le cadre élargi de l’Université Åbo Akademi.
Laura Hellsten est actuellement chercheuse principale du projet Praxis of Social Imaginaries – a Theo-artistic Intervention for Transdisciplinary Knowledge (2024–2028). Ce projet s’articule autour de trois volets : une compréhension théologique des imaginaires sociaux, des cosmologies et des pratiques de lecture polysémiques ; des méthodes de recherche artistique fondées sur l’intervention ; et des modes de production de savoirs autochtones ou traditionnels, incluant l’écoute et la narration. À travers l’organisation de symposiums nomades et communautaires réunissant des participants de toute la région nordique, des étudiants et chercheurs de l’Université Åbo Akademi et du Sud global, ainsi que des artistes et des activistes, le projet vise à cultiver des pratiques de sagesse, à poser des questions audacieuses et à former à une pensée critique sur l’influence persistante des schémas coloniaux dans la société et les universités contemporaines.
9.50 – 10.25 – Mircea Sofonea, Université de Montpellier, France
De l’interdisciplinarité dans la gestion des crises sanitaires – leçons de la recherche menée à Montpellier sur la surveillance et le contrôle pandémique.
En savoir +
La fulgurance inédite de la récente pandémie a nécessité des quantifications rapides et précises afin d’éclairer au mieux la réponse sanitaire. Cette présentation dressera un panorama des recherches menées à Montpellier depuis début 2020 sur l’épidémie de SRAS-CoV-2 en France métropolitaine, à l’interface entre la virologie, la biologie évolutive, la santé publique et les mathématiques appliquées. Au-delà sera discutée, à la lumière d’un recul de cinq années, la place des approches interdisciplinaires quantitatives en temps réel lors d’une crise sanitaire, en tant que source de preuves originales, d’aide à la décision, et de contribution à la sensibilisation et à la confiance de la société.

Mircea Sofonea
Maître de conférences en épidémiologie et évolution des maladies infectieuses
Université de Montpellier, France
Doctorat en évolution des systèmes infectieux
Unité de recherche Pathogenèse et contrôle des infections chroniques et émergentes (PCCEI), Université de Montpellier, INSERM
Epidémiologiste au Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes (CHU)
Biologiste initié aux mathématiques appliquées, Mircea T. Sofonea est maître de conférence à l’Université de Montpellier depuis 2018, où il enseigne notamment l’analyse spatiale, les biostatistiques, l’épidémiologie et les processus stochastiques dans des cursus de biologie, pharmacie et médecine. Formé aux stratégies anti-infectieuses et aux bases de données de santé, il est aussi épidémiologiste au CHU de Nîmes.
Au sein de l’unité mixte de recherche PCCEI (Université de Montpellier, INSERM), il co-dirige l’axe de modélisation, abordant des questions de recherche fondamentales et appliquées relatives à l’épidémiologie, l’évolution et le contrôle des virus respiratoires. Membre exécutif de la fédération hospitalo-universitaire d’infectiologie de Montpellier-Nîmes (FHU TIE) et de l’Action Coordonnée Modélisation (ANRS | MIE), il co-organise des événements transdisciplinaires annuels relatifs aux maladies infectieuses. En tant que membre du groupe d’expertise Air & COVID de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), il apporte régulièrement son expertise aux médias et aux décideurs.
Depuis 2022, Mircea T. Sofonea est le responsable recherche de l’Institut ExposUM, en charge de l’accélération de projet interdisciplinaires sur la santé environnementale portés par l’Université de Montpellier et ses partenaires. Il consiste en l’établissement d’un institut hors-les-murs dédié à la recherche sur l’exposome et la santé environnementale plus généralement. L’exposome représente l’ensemble des facteurs environnementaux et sociaux qui, combinés aux caractéristiques intrinsèques de l’individu, gouvernent l’apparition, l’évolution et la gravité des maladies infectieuses et non transmissibles. Dans l’Institut, l’exposome est abordé au travers de quatre approches complémentaires : les mécanismes biologiques de l’exposition, la surveillance de l’exposition environnementale, l’écologie hôte-pathogène-vecteur et l’interaction entre l’exposome et la santé humaine.
L’Institut est structuré autour de trois missions principales : la recherche, la formation et l’interface science-société. Ces axes travaillent de concert en organisant des appels à propositions annuels et en animant la communauté montpelliéraine de recherche sur l’exposome, soutenant actuellement plus de 40 projets. En accord avec ses ambitions scientifiques et sociétales, ExposUM encourage l’interdisciplinarité, les nouvelles collaborations, une perspective One Health et Global Health, la mobilisation des ressources régionales ainsi qu’une recherche ouverte et durable.
10.25-11.00 – Judit Mádl-Szőnyi, Université Eötvös Loránd, Hongrie
Des écoulements souterrains à l’adaptation sociétale au climat : un parcours transdisciplinaire.
En savoir +
Les extrêmes hydroclimatiques, tels que les sécheresses et les excédents d’eau, entraînent des répercussions profondes sur de vastes territoires, les populations et les économies. Garantir un approvisionnement en eau fiable, tant pour les besoins humains que pour les écosystèmes, constitue un défi majeur. Souvent négligée, les eaux souterraines jouent pourtant un rôle crucial dans la régulation des périodes humides et sèches. La recharge gérée des aquifères (Managed Aquifer Recharge – MAR) est une technique qui permet de stocker l’eau excédentaire durant les saisons pluvieuses pour une utilisation en période de sécheresse. L’approche NaBa-MAR, développée par le groupe d’hydrogéologie d’ELTE, a été mise en œuvre dans le cadre du projet ClimEx-PE porté par les universités de l’alliance CHARM-EU. Ce projet intègre les méthodes locales de MAR à une compréhension des écoulements souterrains à l’échelle régionale afin d’atténuer les phénomènes hydrologiques extrêmes. Une diffusion efficace de cette approche auprès des décideurs et du grand public est essentielle. L’exposé développe le concept NaBa-MAR, sa démonstration physique à des fins pédagogiques ainsi que ses possibilités de mise en œuvre à travers une campagne de sensibilisation ciblant les sociétés et les parties prenantes.

Judit Mádl-Szőnyi
Maître de conférences en hydrogéologie
Université Eötvös Loránd, Hongrie
Doctorat (PhD) et Doctorat ès sciences (DSc) en hydrogéologie
Responsable de la Chaire d’hydrogéologie József et Erzsébet Tóth
Vice-doyenne pour les affaires stratégiques et l’innovation de la Faculté des sciences d’ELTE
Judit Mádl-Szőnyi est une spécialiste de l’hydrogéologie, plus particulièrement dans les systèmes régionaux d’écoulement des eaux souterraines et de l’hydrogéologie des bassins. Avec plus de trois décennies d’enseignement et de recherche à son actif, elle a contribué de manière significative à la compréhension des forces motrices des eaux souterraines, des schémas d’écoulement et des liens étroits existant entre les systèmes d’écoulement des eaux souterraines et les schémas de végétation. Les travaux de son groupe de recherche ont été reconnus au niveau international.
Elle a développé des modèles d’écoulement des eaux souterraines pour les aquifères carbonatés profonds et a encouragé la gestion de la recharge des aquifères avec des solutions naturelles. Ses recherches interdisciplinaires portent également sur le changement climatique et ses incidences sur les eaux souterraines, les possibilités d’adaptation et l’utilisation durable de l’énergie géothermique. Ses travaux ont influencé les milieux universitaires et contribué à des applications pratiques en termes de gestion de l’environnement et d’élaboration des politiques publiques. En outre, elle participe activement à la formation de la prochaine génération d’hydrogéologues en favorisant un environnement de recherche collaboratif et innovant. Depuis 2011, elle préside la Commission régionale sur l’écoulement des eaux souterraines de l’Association internationale des hydrogéologues (AIH) et a dirigé plus de quinze projets de R&D, y compris des projets européens prestigieux. Sa distinction la plus notable est le AIH presidents’ Award.
Au cours des dernières décennies, dans le cadre de ses collaborations avec Shell, MOL R&D et de projets européens d’innovation et de développement, Judit Mádl-Szőnyi a su adapter ses connaissances à l’exploration des hydrocarbures et aux objectifs de la transition énergétique, y compris l’énergie géothermique et les ressources minérales connexes. Judit Mádl-Szőnyi est la chercheuse principale du projet Water4All ClimEX-PE, lancé en 2024 par des universités membres de l’alliance européenne CHARM-EU. Ce projet transdisciplinaire implique des scientifiques issus de divers domaines des sciences naturelles et des chercheurs avec une solide expertise socio-juridique, tout en accordant une attention particulière à l’implication du public par le biais de la communication et de l’éducation.
11.00– 11.15 – Pause-café
11.15-11.50 – Mark Oelmann, Université des sciences appliquées de la Ruhr-West, Allemagne
La transdisciplinarité dans le domaine de l’eau : possibilités, défis et bonnes pratiques.
En savoir +
La transdisciplinarité est un objectif noble. Pour de nombreux projets, elle représente une condition préalable essentielle afin de garantir que les perspectives les plus diverses soient effectivement prises en compte. C’est la seule façon de garantir la réussite de la mise en œuvre des résultats. En parallèle, les résultats des différentes disciplines doivent s’enrichir mutuellement. Si ce n’est pas le cas, c’est que les chercheurs n’œuvrent pas dans la même direction. Mais ne perdent-ils pas beaucoup de temps en chemin ? Après tout, l’objectif d’un scientifique est de publier des articles… et de le faire dans sa propre discipline. Peut-on sortir de ce dilemme ?

Mark Oelmann
Professeur d’économie de l’eau et de l’énergie
Université des sciences appliquées de la Ruhr-West, Allemagne
Doctorat en économie
Mark Oelmann est le directeur du programme de licence BWL – Gestion de l’énergie et de l’eau à l’Université des sciences appliquées de la Ruhr-West. Au cœur de ce programme : une collaboration forte et diversifiée – par exemple dans le cadre de parcours d’études duales – avec des entreprises et des prestataires de services dans les secteurs de l’énergie et de l’eau. En tant que chercheur, il réalise des études économiques et politiques sur les questions liées à l’eau et s’intéresse aux différentes formes de tarification de l’eau. Il est également impliqué dans des sujets relatifs à la numérisation, tels que l’apprentissage automatique (machine learning) ou la gestion du changement.
Mark Oelmann a grandement contribué à favoriser l’intégration d’une perspective économique dans la réflexion sur la gestion de l’eau. Il a travaillé plus de 25 ans dans le secteur de l’eau et d’autres secteurs connexes, en tant que banquier d’investissement à la Deutsche Bank, consultant en gestion chez Capgemini Consulting et chef de département à l’Institut scientifique pour les services d’infrastructure et de communication (WIK) GmbH. Il collabore avec le ministère fédéral allemand de l’éducation et de la recherche (BMBF) sur des problématiques internationales liées à l’eau, comme récemment sur l’eau et l’agriculture au Pakistan. Une partie de son travail se concentre sur les pays en développement et les pays émergents : Albanie, Chine, Iran, Indonésie, Yémen, Ouganda…
En tant qu’économiste et anthropologue culturel, Mark Oelmann est le porte-parole de l’axe de recherche Économie et gestion de l’eau à l’Université des sciences appliquées de la Ruhr-West, un thème interdisciplinaire impliquant l’institut d’économie et l’institut de génie civil et visant à favoriser un processus de transformation vers une gestion durable de l’eau. Il est également co-associé et co-directeur général d’une société de conseil issue de l’Université des sciences appliquées de la Ruhr-West : MOcons. Fortement impliqué dans les questions en lien à l’eau, il fait partie d’un réseau de bénévoles qui soutient les jeunes entreprises dans la construction d’un avenir énergétique plus durable.
11.50-12.25 – Quique Bassat, Institut de Barcelone pour la santé mondiale (ISGlobal), Espagne
Quelques mots sur la santé mondiale : enjeux et menaces.
En savoir +
Nous vivons dans un monde de contrastes. Le lieu de votre naissance détermine de façon significative vos chances de survie et d’épanouissement, que vous naissiez en bonne santé ou malade. Dans cette présentation, certaines de ces inégalités en matière de santé seront examinées, ainsi que les tendances actuelles en santé mondiale, notamment la menace persistante que représentent les maladies infectieuses à l’échelle globale. Ces enjeux seront abordés dans le contexte d’une planète en mutation, marquée par les incertitudes liées à la crise climatique — une crise qui, bien que méconnue de beaucoup, aura un impact sur la santé de tous, et plus particulièrement sur celle des enfants nés dans les régions les plus pauvres du monde.

Quique Bassat
Pédiatre
Directeur de l’Institut de Barcelone pour la santé mondiale (ISGlobal), Espagne
Doctorat en médecine
Enseignant-chercheur ICREA
Pédiatre spécialisé dans l’épidémiologie des maladies infectieuses et la santé publique, Quique Bassat a toujours tenté de combiner son travail clinique avec la recherche biomédicale sur les maladies qui affectent le plus les populations défavorisées et les personnes vulnérables. Son principal domaine d’étude est la prévention et le traitement du paludisme chez l’enfant, en particulier la compréhension du chevauchement clinique du paludisme et d’autres affections pédiatriques courantes. Ses recherches ont également porté sur le nouveau paradigme de l’éradication du paludisme, notamment l’évaluation du rôle des médicaments dans les stratégies d’élimination.
Il a aussi travaillé sur la caractérisation de l’épidémiologie et de l’étiologie des infections respiratoires (virales et bactériennes), des maladies diarrhéiques et des infections néonatales dans des pays tels que le Mozambique, le Maroc ou le Bhoutan. Actuellement, il s’intéresse principalement à la validation et à l’implémentation d’outils d’autopsie minimement invasifs (MIA) pour la recherche post-mortem des causes de décès dans les pays en développement. Il s’intéresse également de près à la validation et à l’évaluation de dispositifs technologiques à faible coût destinés à améliorer la santé dans les pays défavorisés.
Depuis 2024, Quique Bassat est le directeur général de l’Institut de Barcelone pour la santé mondiale (ISGlobal), où il dirige une équipe d’envergure (près de 600 personnes) engagée dans l’amélioration de la santé mondiale et la promotion de l’équité en matière de santé. L’ISGlobal est le résultat d’une alliance innovante entre la fondation “La Caixa”, des institutions académiques et des organismes gouvernementaux afin de contribuer aux efforts entrepris par la communauté internationale pour relever les défis de santé dans un monde globalisé. Ce pôle de recherche d’excellence tire son expertise du monde de la santé, avec l’hôpital Clínic de Barcelone et le Parc de Salut MAR, et de la sphère académique, avec l’Université de Barcelone et l’Université Pompeu Fabra.
12.25-12.55 – Débat
Avec Ronald Österbacka, Mircea Sofonea, Judit Mádl-Szőnyi, Mark Oelmann et Quique Bassat.
13.00-14.00 – Pause déjeuner
14.00 – 17.10 – Session de l’après-midi
14.05 – 14.40 – Jennifer Edmond, Trinity College Dublin, Irlande
La réalité des imaginaires ? Explorer le présent et l’avenir des études littéraires appliquées.
En savoir +
Les disciplines qui composent les humanités ont longtemps constitué une énigme en matière de transdisciplinarité. Cette présentation examinera la manière dont la littérature semble émerger en tant que catégorie de preuves au sein de la recherche appliquée, sans que ne se développe en parallèle, comme on pourrait s’y attendre, un véritable champ transdisciplinaire des études littéraires. Elle s’interrogera sur les raisons de cet état de fait et sur les leviers nécessaires pour une meilleure intégration des études littéraires et leurs potentiels “utilisateurs”, notamment en s’inscrivant dans le contexte contemporain des tensions entre la culture et les technologies de la connaissance en plein essor, telles que l’intelligence artificielle.

Jennifer Edmond
Maître de conférences en humanités numériques
Trinity College Dublin, Irlande
Doctorat en langues et littératures germaniques
Codirectrice du Trinity Center for Digital Humanities
Jennifer Edmond est une experte internationalement reconnue pour son expertise dans l’application des connaissances en art et en sciences humaines aux défis académiques et sociétaux qui se posent à l’intersection des technologies de l’information et de la communication et de la culture. Elle ambitionne de valoriser sa position de leader dans le domaine des humanités numériques pour faire progresser de manière significative la consolidation du sous-domaine émergent des humanités numériques critiques. La plupart de ses publications sont en libre accès.
Ancienne présidente (2018-2022) du conseil d’administration de l’infrastructure de recherche paneuropéenne pour l’art et les humanités DARIAH-EU, Jennifer Edmond a joué un rôle de premier plan dans de nombreux développements stratégiques au niveau national et institutionnel. Elle a mis son savoir-faire en matière de développement d’infrastructures au service d’un large éventail d’initiatives et d’agences, de l’industrie alimentaire à l’agence maritime nationale coréenne. Elle a coordonné de nombreux projets de recherche interdisciplinaire d’envergure, comme CENDARI FP7 (2012-2016), une infrastructure européenne collaborative d’archivage numérique. Elle a également été partenaire du cluster PARTENHOS, dont l’objectif était de renforcer la cohésion de la recherche dans plusieurs domaines associés aux humanités.
KT4D est son projet le plus récent sur l’IA, le big data et la démocratie. Piloté par le Trinity College de Dublin avec un consortium de douze organisations partenaires, le projet Knowledge Technologies for Democracy (KT4D) étudie comment la démocratie et la participation civique peuvent être mieux facilitées face à des technologies de la connaissance à évolution rapide telles que l’intelligence artificielle et les mégadonnées. Ceci afin de permettre aux différents acteurs qui composent la société de capitaliser sur les nombreux bénéfices que ces technologies peuvent apporter en termes d’autonomisation des communautés, d’intégration sociale, de capacité d’action individuelle et de confiance dans les institutions et les instruments technologiques, tout en identifiant et en atténuant les potentiels risques éthiques, juridiques et culturels.
14.40- 15.15 – Isabel Feichtner, Université Julius-Maximilians de Würzburg, Allemagne
Réorienter le droit vers le(s) commun(s).
En savoir +
Cette présentation s’interrogera sur le rôle du droit et des juristes dans les processus de transformation socio-écologique. En se référant aux mouvements sociaux qui s’opposent à l’appropriation et à l’extraction de valeur à partir des communs, elle propose une conceptualisation du droit transformatif articulée autour de trois dimensions : premièrement, un “contre-droit” visant à démanteler les infrastructures juridiques de l’extraction de valeur ; deuxièmement, une interprétation transformative des droits (notamment de propriété) ; et troisièmement, un droit de l’organisation des communs. La présentation vise en outre à illustrer la manière comment ce droit transformatif peut être promu par une recherche transdisciplinaire, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’université.
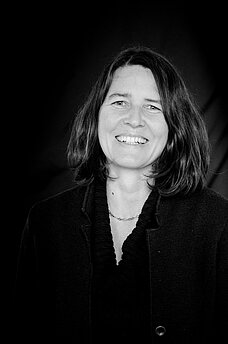
Isabel Feichtner
Professeure de droit public et de droit économique international
Université Julius-Maximilians de Würzburg, Allemagne
Doctorat en droit
Fondatrice de la Law Clinic Transformation Law
Les travaux de recherche d’Isabel Feichtner trouvent leurs fondements dans la pratique. Dès la fin de ses études, elle a été admise au barreau de New York et a travaillé pendant un an pour le bureau new-yorkais du cabinet d’avocats Cravath, Swaine & Moore en tant que collaboratrice dans le domaine de la titrisation. Aujourd’hui, ses recherches portent sur les effets distributifs du droit, la démocratisation de la société ainsi que le droit et la pratique des communs. Elle étudie comment les expériences institutionnelles, telles que la refonte de la monnaie ou les partenariats public-privé, peuvent soutenir la transformation socio-écologique par le biais de la démocratisation des communs. Son expertise porte sur le droit international, le droit et l’économie politique, le droit international de l’extraction des ressources naturelles et le droit financier.
De 2022 à 2024, Isabel Feichtner a été chercheuse associée à The New Institute à Hambourg, un programme de fellowship résidentielles conçu pour nourrir la transformation par la collaboration interdisciplinaire et transsectorielle, où elle a dirigé le programme Reclaiming common wealth : vers un droit et une économie des communs fonciers. Ce programme a exploré les voies, les processus et les modèles institutionnels pour la création et la gouvernance des communs fonciers. Et ce afin de répondre aux mécontentements découlant des investissements fonciers institutionnels, d’évaluer les théories et les concepts de propriété et de valeur, et d’établir un référentiel du droit et de la conception institutionnelle des communs fonciers.
Isabel Feichtner est la fondatrice de la Law Clinic Transformation Law, laquelle est à la fois un format d’enseignement et un forum pour la recherche transdisciplinaire afin d’explorer la capacité du droit à contribuer pleinement à une économie politique démocratisée. Elle considère ce projet comme une tentative de démocratisation du droit et de l’enseignement juridique en vue d’un changement socio-écologique majeur, convaincue que le droit transformatif doit permettre de repenser comme de redessiner les institutions et les infrastructures au cœur de l’économie politique, telles que la propriété, la monnaie et l’entreprise.
15.15 -15.30 – Pause-café
15.30 – 16.05 – Rasmus Slaattelid, Université de Bergen, Norvège
La transdisciplinarité en tant que multiculturalisme académique.
En savoir +
Cette présentation s’appuiera sur des expériences de recherche et d’enseignement dans des contextes interdisciplinaires et transdisciplinaires. Les appels en faveur de la transdisciplinarité suscitent des inquiétudes légitimes quant à un possible affaiblissement de la formation et de la recherche fondées sur les disciplines. L’idée générale peut être résumée par l’adage : « Il faut apprendre à marcher avant de courir ». Ou plus largement par la conviction que le développement de compétences interdisciplinaires nécessite une base solide acquise dans une seule et même discipline. À partir d’exemples tirés de projets transdisciplinaires en cours ou achevés, ainsi que d’expériences pédagogiques menées au Centre d’étude des sciences et des humanités (SVT), il s’agira de proposer une approche translationnelle de la transdisciplinarité, inspirée du concept d’« expertise interactionnelle » développé par Collins et Evans.

Rasmus T. Slaatelid
Professeur de philosophie des sciences
Université de Bergen, Norvège
Doctorat en philosophie
Directeur du Centre d’étude des sciences et des humanités (SVT)
Rasmus Slaattelid est professeur de philosophie des sciences et directeur du Centre d’étude des sciences et des humanités (SVT) de l’Université de Bergen. Ce centre dispense des cours aux doctorantes et doctorants sur les problématiques philosophiques, sociétales et éthiques de la science et de la technologie, et mène des recherches sur les thématiques associées. Les activités de recherche et d’enseignement nécessitent un dialogue entre disciplines scientifiques et cultures académiques, mais aussi entre différentes formes de savoir et pratiques de connaissance.
Les recherches de Rasmus T. Slaattelid portent principalement sur la traduction entre les cultures épistémiques. Il participe à plusieurs groupes de recherche à l’université de Bergen. Ses travaux de recherche les plus récents sont accessibles en ligne. Publié en 2023, le livre Translations of Responsibility : Innovation Governance in Three European Regions (Traductions de la responsabilité : gouvernance de l’innovation dans trois régions européennes) détaille comment un projet de recherche financé par Horizon 2020 a mis en pratique la recherche et l’innovation responsable (RRI), depuis la philosophie de la technologie jusqu’au jargon politique de l’UE, en passant par les événements de la vie réelle dans ces régions. En 2020, un groupe de chercheurs européens a obtenu une subvention de l’Union européenne (UE) pour réaliser un projet appelé TRANSFORM. L’objectif de ce projet était d’intégrer le principe de recherche et d’innovation responsable (RRI) dans les politiques de recherche et d’innovation de trois régions européennes : Lombardie, Bruxelles et Catalogne. Le livre analyse le contexte plus large l’aspiration à une meilleure gouvernance des technosciences et propose de penser la gouvernance dans les technosciences, plutôt que la gouvernance des technosciences. Sur le même sujet, l’article Traduire les outils et indicateurs de la RRI territoriale s’efforce de documenter et d’évaluer les réalisations de TRANSFORM à l’aide d’une enquête évaluative et d’un raisonnement théorique, tandis que l’article Traductions transformatrices ? Challenges and tensions in territorial innovation governance | NOvation – Critical Studies of Innovation présente une analyse comparative de différents pilotes territoriaux de RRI dans le cadre du projet européen et réfléchit au concept-même de RRI.
16.05 -16:40 – Iris van der Tuin, Université d’Utrecht, Pays-Bas
La pensée connective : stratégies pour établir des liens entre savoirs spécialisés.
En savoir +
Inspirée par le philosophe français Michel Serres (1930-2019), cette présentation propose une réflexion sur des expériences institutionnelles, de recherche et d’enseignement centrées sur la création de connexions entre savoirs spécialisés. Il est courant d’affirmer que la complexité dynamique des problèmes socio-environnementaux rend ces connexions plus urgentes que jamais. Mais qu’en est-il aujourd’hui au sein de la communauté universitaire, en particulier en ce qui concerne les étudiantes et étudiants et les jeunes chercheurs et chercheuses ? Quels savoirs, compétences et attitudes transversales doivent-ils développer ? Comment peut-on enseigner ces SCA et pourquoi est-ce important ? Et que peuvent apprendre les personnels universitaires en poste de de la jeune génération ? Au cœur de cette présentation, plusieurs stratégies éprouvées de « pensée connective », conçues pour favoriser l’inter- et la trans-disciplinarité.

Iris van der Tuin
Professeure de théorie de l’enquête culturelle
Université d’Utrecht, Pays-Bas
Doctorat en humanités
Chaire Théorie de l’enquête culturelle
Doyenne de l’enseignement interdisciplinaire de l’Université d’Utrecht
Epistémologiste féministe de formation, spécialiste de l’interdisciplinarité par l’expérience, Iris van der Tuin évolue à l’intersection de la philosophie des sciences et des humanités, de la théorie culturelle et des pratiques critiques et créatives de l’enquête culturelle. Elle s’intéresse aux nouvelles humanités interdisciplinaires et aux approches théoriques et pratiques relatives à la recherche sur l’enseignement et l’apprentissage de l’interdisciplinarité. Le nom de sa chaire est Théorie de l’enquête culturelle, car elle croit profondément qu’il y a de la place pour des philosophies et des théories de la connaissance enrichies par des réflexions sur les humanités et sur la façon dont ces dernières ne se contentent pas d’étudier les œuvres de la culture, mais travaillent également avec les artistes.
En 2014-18, Iris van der Tuin a présidé COST Action New Materialism: Networking European Scholarship on ‘How Matter Comes to Matter’. Elle a ensuite travaillé sur le projet H2020 Ethics of Coding : Un rapport sur la condition algorithmique. En 2020, elle a fondé le Susanne K. Langer Circle, un groupe international et multidisciplinaire qui s’intéresse à l’œuvre de la philosophe américaine Susanne Langer. Elle est également coéditrice et fondatrice de la collection de livres New Materialisms à Edinburgh University Press et du numéro spécial Practice-based Research of Interdisciplinary Higher Education de HSSCOMMS, une publication de la revue Nature.
Ses recherches font partie du groupe Transmission in Motion de l’Institute of Cultural Inquiry (ICON) de l’Université d’Utrecht, une communauté de recherche hybride réunissant des chercheurs et chercheuses de différentes disciplines, des artistes ainsi que d’autres parties prenantes externes, et qui se concentre sur la manière dont les développements technologiques reconfigurent nos sens. Les archives sont transformées en “dynarchives”, mettant en mouvement les cultures du savoir. Le mouvement, la gestuelle et l’interaction incarnée sont également au cœur de nouvelles perspectives sur les pratiques incarnées d’enseignement et d’apprentissage, de création et de performance. Cela nécessite de nouveaux concepts et de nouvelles méthodes, ouvrant de nouveaux horizons transdisciplinaires pour la recherche et le développement, et offrant de nouvelles possibilités de collaborations intersectorielles entre les sciences humaines, les sciences et les arts, ainsi qu’avec des partenaires sociétaux et industriels.
Iris est également membre de l’Institut de recherche pour la philosophie et les études religieuses (OFR) de l’université d’Utrecht. Cet institut est un lieu de réflexion sur l’interdisciplinarité dans la recherche, l’enseignement et l’apprentissage d’un point de vue historique, philosophique et empirique. Avec son groupe, elle a publié Key Texts on Interdisciplinary Higher Education (Textes clés sur l’enseignement supérieur interdisciplinaire) pour Bristol University Press.
16.40 – 17.10 – Débat
Avec Jennifer Edmond, Isabel Feichtner, Rasmus Slaattelid et Iris van der Tuin.
Cette conférence se déroulera intégralement en anglais.
Sur inscription seulement jusqu’au 17 juin. Gratuit. En live (puis en replay) sur la chaîne YouTube de l’UM.
Recevoir un récapitulatif de l’agenda de l’UM chaque semaine
* En renseignant votre mail vous acceptez de recevoir chaque semaine le récapitulatif de l’agenda de l’UM par courrier électronique et vous prenez connaissance de notre politique de confidentialité. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment à l’aide du lien de désinscription ou en nous contactant par mail.
