L’Accord franco-algérien de 1968 est-il en sursis ?
Une nouvelle fois tenu pour « cause de l’échec » de la gestion de l’immigration algérienne, l’Accord franco-algérien de 1968 a aussi été récemment brocardé par l’ancien Premier ministre Édouard Philippe qui, début juin, annonçait envisager sa dénonciation.
Hocine Zeghbib, Université de Montpellier
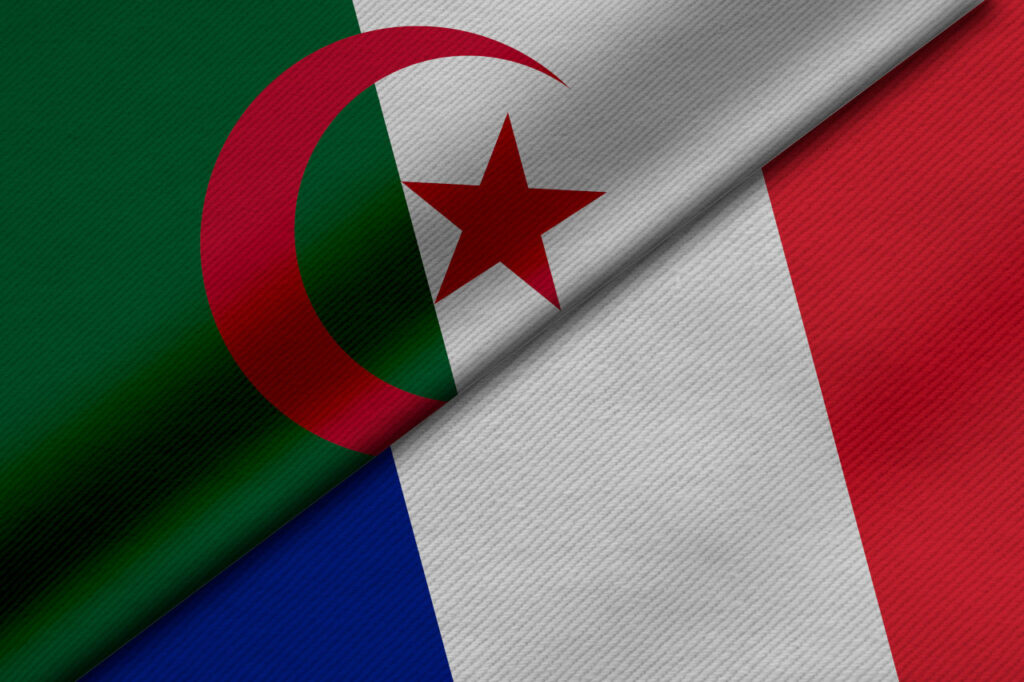
Né de circonstances historiques particulières liées aux Accords d’Évian, l’Accord de 1968 vise à réorganiser la circulation postindépendance des personnes entre les 2 pays. Le Conseil d’État en a constaté le caractère spécifique et conclu que sur les sujets dont il traite, les règles générales du droit commun regroupées dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens. Pour autant, l’Accord de 1968 n’a pas échappé à l’influence du Ceseda au fil des 3 avenants qu’il a intégrés.
Quels droits si exorbitants ouvre-t-il aujourd’hui qu’il faille en finir ? L’hypothèse, grosse de sérieuses difficultés diplomatiques et humaines, est-elle juridiquement réalisable ?
Des intérêts mal identifiés à l’origine, vite redéfinis
Les Accords d’Évian du 18 mars 1962, énoncent : « sauf décision de justice, tout Algérien muni d’une carte d’identité est libre de circuler entre l’Algérie et la France ». Ces Accords garantissent aux « Pieds-noirs » qui choisissent la nationalité algérienne le droit de circuler librement entre les deux pays. Les départs massifs de l’été 1962 en ont décidé autrement. La libre circulation, qui ne leur a pas toujours été accordée bien que sujets puis nationaux français, profitait finalement et essentiellement aux Algériens “ex-indigènes”.
Débuta en 1963 une politique de contingentement du nombre de travailleurs algériens se rendant en France. Accord est conclu en 1964 pour en limiter le volume. Décidée par consentement mutuel des 2 pays (accord contractuel) pour une durée déterminée, la limitation ne porte que sur la main-d’œuvre salariée. Cet accord est dénoncé en 1966. https://www.youtube.com/embed/GKNennlBIm8?wmode=transparent&start=0
S’ensuit la signature le 27 décembre 1968 de l’Accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles.
Une tendance à la baisse du niveau de protection
L’Accord vise à réduire l’immigration de la main d’œuvre salariée. Il fixe un contingent annuel révisable de 35 000 travailleurs, chacun devant, pour bénéficier d’un titre de séjour de 5 ans, trouver un emploi sous 9 mois. Un « certificat de résidence d’Algérien » (CRA), d’une validité de 5 ans pouvant être réduite en cas de chômage, est délivré aux travailleurs salariés ou non-salariés et aux Algériens résidant en France disposant de ressources suffisantes. Un CRA de 10 ans est délivré aux Algériens déjà présents depuis 3 ans. Il préserve la libre circulation des Algériens « se rendant en France sans intention d’y exercer une activité professionnelle salariée ».
En septembre 1973, l’Algérie décide l’arrêt de l’émigration de travail vers la France. En 1974, la France décide de suspendre toute immigration. Dans la foulée, le renvoi de 500 000 Algériens sur 5 ans entre dans l’agenda gouvernemental. Les difficiles négociations de 1978-1979 restreignent cet objectif. Sont prises, sans grande efficacité, des mesures de « retour volontaire ». En 1983, un nouvel accord restreint la libre circulation pour visite privée ou familiale.
En 1985, est signé le premier avenant à l’Accord de 1968. Son niveau de protection est quasiment calqué sur le droit commun des étrangers de l’époque. L’avenant en transpose la durée des titres de séjour : 1 an et 10 ans. La liberté d’établissement pour les professions non-salariées et la liberté de circulation des touristes sont maintenues. Cet avenant marque pourtant le point de départ de l’érosion progressive de l’Accord de 1968.
L’instauration en 1986 du visa d’entrée en France lui porte un coup sévère. Celle-ci déclenche, par réciprocité, l’instauration d’un visa d’entrée en Algérie. La « libre circulation » est dès lors dépendante de la politique des visas.
L’avenant de 1994, complété par échange de lettres, limite l’absence du territoire à 3 ans sous peine de péremption du CRA. Les visites privées et familiales sont soumises, outre le visa, à la production d’un certificat d’hébergement, d’un justificatif de ressources et d’un billet de transport aller-retour. https://www.youtube.com/embed/0XZAULuySyo?wmode=transparent&start=0
En 2001, un dernier avenant aligne l’Accord sur la loi Chevènement de 1998 globalement plus favorable aux étrangers. Il fige le statut des Algériens dans l’état d’alors. L’arrivée de Nicolas Sarkozy à la présidence relance les critiques et, fin 2010, un projet de quatrième avenant, resté sans suite, est discuté.
Un niveau de protection affecté par le Ceseda
Si l’Accord de 1968 reste le mètre-étalon des règles régissant les immigrés algériens, il ne les soustrait pas pour autant aux règles de procédure du Ceseda applicables à tous les étrangers. Leur sont aussi applicables mesures d’éloignement, contrôles et sanctions et droit d’asile car non inclus dans l’Accord de 1968.
Que reste-t-il de l’Accord de 1968 qui justifierait critiques sévères et appels à le dénoncer ?
Sans être exhaustif, on relèvera quelques avantages spécifiques non-négligeables. Ainsi, de la liberté d’établissement. Un Algérien porteur d’un projet commercial ou artisanal n’a pas à prouver, préalablement à l’obtention du premier titre de séjour, la viabilité de son activité. Ce n’est pas le cas pour les étrangers relevant du Ceseda. Un Algérien peut obtenir un titre de séjour de 10 ans après 1 an de séjour régulier quand il en faut 3 pour l’étranger relevant du Ceseda. Le conjoint·e algérien de Français·e peut obtenir un titre de séjour dès lors qu’il entre en France muni d’un visa de court séjour. Le Ceseda exige un visa de long séjour.
En contrepoint, certains avantages induits des lois votées depuis 2004 ne bénéficient que par exception aux Algériens. Il en va ainsi de la « régularisation par le travail » des sans papiers ou de la régularisation pour “motifs humanitaires” de la loi de 2004. L’étudiant algérien doit renouveler son titre de séjour chaque année, ne pouvant prétendre au titre pluriannuel du Ceseda. S’il se retrouve dans l’irrégularité, 15 ans de présence sont nécessaires pour une hypothétique régularisation, contre 10 ans pour les autres étrangers. En termes d’emploi étudiant, la durée de travail qui lui est autorisée est inférieure à celle du Ceseda. Dans le regroupement familial du Ceseda, le visa long séjour du membre rejoignant vaut titre de séjour de 1 an. L’Algérien rejoignant porteur du même type de visa doit se rendre à la préfecture dans les 2 mois de son arrivée pour demander délivrance du premier titre de séjour.
[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]
Globalement, l’Accord franco-algérien, s’il conserve quelques avantages, n’est plus si protecteur, son contenu originel ayant été érodé au fil des avenants et de la complexité croissante des procédures spécifiques au Ceseda qui s’imposent aussi aux Algériens. Son intérêt réside en ce que les règles de fond régissant les Algériens ne peuvent être modifiées unilatéralement. En cela, il n’est pas différent des autres accords bilatéraux conclus en la matière à la différence notable que ces derniers ne portent que sur quelques points particuliers.
Une dénonciation juridiquement mal assurée
Selon le principe pacta sunt servanda, les parties à un traité sont tenues de l’exécuter. Un traité peut être légalement dénoncé exclusivement si les conditions sine qua non sont remplies. L’existence d’une clause qui en prévoit la dénonciation en est la principale. L’Accord de 1968 ne contient pas cette clause.
En revanche, il contient un article 12 créant une commission mixte franco-algérienne. Celle-ci est chargée de suivre l’application de l’Accord et d’en résoudre les difficultés. Ses négociateurs ont voulu que toute difficulté soit réglée par cette commission. C’est donc sciemment que la clause de dénonciation n’a pas été incluse.
La dénonciation fondée sur la nature du traité, qui implique son « extinction naturelle » une fois ses objectifs atteints, n’est pas moins hasardeuse. Ce texte tire en effet sa source des Accords d’Évian. De ce fait, il participe à la poursuite de relations bilatérales conçues par les signataires pour être pérennes.
Enfin, sa dénonciation aurait pour conséquence de rétablir le statu quo ante, c’est-à-dire les droits issus des Accords d’Évian, donc, en droit… la libre circulation des Algériens entre l’Algérie et la France ! Quel bénéfice alors à dénoncer cet accord, sauf à poursuivre un objectif politique singulier ?
Hocine Zeghbib, Maître de conférences HDR honoraire, Université Paul-Valéry- Montpellier IIII, chercheur au CREAM- Faculté de droit, Université Montpellier, Université de Montpellier
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.